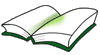Auteur Jean-Christophe FoltÊte
|
|
Documents disponibles écrits par cet auteur (41)


 Ajouter le rÃĐsultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le rÃĐsultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externesLes relations entre dynamique sociale et occupation du sol dans une rÃĐgion particuliÃĻre: la petite Montagne / Boillot RÃĐgis
Titre : Les relations entre dynamique sociale et occupation du sol dans une rÃĐgion particuliÃĻre: la petite Montagne Type de document : mÃĐmoire, rapport de stage Auteurs : Boillot RÃĐgis ; Jean-Christophe FoltÊte, Direction/Jury AnnÃĐe de publication : 1999 Note gÃĐnÃĐrale : Université de Besançon Laboratoire : Inconnu Equipe : Paysage & Cadre de vie Type : Thèse, mémoire Publication de Théma : Non Les relations entre dynamique sociale et occupation du sol dans une rÃĐgion particuliÃĻre: la petite Montagne [mÃĐmoire, rapport de stage] / Boillot RÃĐgis ; Jean-Christophe FoltÊte, Direction/Jury . - 1999.
Université de Besançon
Laboratoire : Inconnu Equipe : Paysage & Cadre de vie Type : Thèse, mémoire Publication de Théma : Non RÃĐservation
RÃĐserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Section DisponibilitÃĐ 5580 MEM.10999 ThÃĻse/MÃĐmoire Archives Disponible
Titre : Satisfaction rÃĐsidentielle et configurations spatiales en milieu pÃĐriurbain Titre original : Residential satisfaction and spatial configurations in a periurban area Type de document : thÃĻse Auteurs : Samy Youssoufi, Auteur ; Jean-Christophe FoltÊte, Directeur de thÃĻse ; Caruso G., Direction/Jury ; LÃĐna Sanders, Direction/Jury Editeur : ThÃĐMA AnnÃĐe de publication : 2011 Importance : 363 p. Note gÃĐnÃĐrale : Université de Franche-Comté. Thèse de doctorat de géographie Langues : Français (fre) Tags : satisfaction rÃĐsidentielle cadre de vie pÃĐriurbain mÃĐtriques spatiales modÃĐlisation amÃĐnitÃĐs paysage accessibilitÃĐ landscape accessibility spatial metrics amenities modelling indicators periurban area residential satisfaction residential environment RÃĐsumÃĐ : Depuis les annÃĐes 1960, les villes françaises sont soumises à un processus d'ÃĐtalement urbain. Cet ÃĐtalement se traduit par l'ÃĐmergence d'une catÃĐgorie d'espace situÃĐe à l'interface entre la ville et la campagne : le pÃĐriurbain. Les caractÃĐristiques sociales, urbanistiques, ou liÃĐes aux pratiques spatiales de ses habitants confÃĻrent au pÃĐriurbain une singularitÃĐ et une spÃĐcificitÃĐ propres. Il s'agit d'un espace de contradiction qui attire à la fois en raison du cadre de vie plutÃīt ÂŦ naturel Âŧ qu'il offre aux mÃĐnages, mais ÃĐgalement en raison de sa proximitÃĐ avec la ville et des potentialitÃĐs liÃĐes à l'accessibilitÃĐ Ã diverses amÃĐnitÃĐs urbaines.Pour comprendre plus finement cet engouement pour le pÃĐriurbain, cette thÃĻse propose d'explorer la relation individu-environnement rÃĐsidentiel sous l'angle de la satisfaction que retirent les individus de leur cadre de vie. Il s'agit de mettre en relation une information de nature cognitive avec une information de nature spatiale. En modÃĐlisant chacune de ces composantes par l'utilisation d'indicateurs spÃĐcifiques, divers modÃĻles statistiques sont mobilisÃĐs pour mettre en lumiÃĻre les attributs spatiaux du cadre de vie susceptibles d'avoir une influence sur la satisfaction des individus.L'approche modÃĐlisatrice est centrale dans la dÃĐmarche suivie. AprÃĻs voir menÃĐ une enquÊte de satisfaction sur plus d'un millier de mÃĐnages vivant dans un secteur pÃĐriurbain de Besançon, la dÃĐmarche s'est attelÃĐe à construire des indicateurs en vue de caractÃĐriser deux types d'amÃĐnitÃĐs de leur environnement rÃĐsidentiel : le paysage et l'accessibilitÃĐ aux commerces et services. Chacune de ces amÃĐnitÃĐs est ensuite intÃĐgrÃĐe dans des modÃĻles statistiques permettant d'ÃĐvaluer leur contribution dans le degrÃĐ de satisfaction du mÃĐnage.La dÃĐmarche, essentiellement modÃĐlisatrice et exploratoire, offre toutefois des perspectives intÃĐressantes dans le domaine de l'amÃĐnagement du territoire et de la planification urbaine. En ayant recours à des modÃĻles simples et reproductibles, il s'agit de d'ÃĐtablir des documents cartographiques dÃĐcrivant le potentiel de satisfaction à grande ÃĐchelle.
Since the 1960s, French cities are concerned with an urban sprawl process. This urban sprawl leads to the emergence of a particular space located at the interface between the city and the countryside: the periurban. The social, morphological or the spatial practices of its inhabitants give the suburban a particular singularity and specificity. It is a space of contradiction that attracts both because of the "natural" living environment that it provides to households, but also because of its proximity to the city and the opportunities related to accessibility to various urban amenities.To understand more precisely this enthusiasm for periurban areas, this thesis proposes to explore the individual-residential environment relationship in terms of the satisfaction. The aim is to link a cognitive information with a spatial information. By modeling each of these components by the use of specific indicators, various statistical models are used to highlight the spatial attributes of the living environment that influence the satisfaction level of individuals.The modeling approach is central in this thesis. After the establishment of a satisfaction survey conducted on more than one thousand households living in a suburban area of ââBesancon, the process is to build indicators to characterize two types of residential amenities: the landscape and the accessibility to shops and services. Each of these amenities is then incorporated into statistical models to assess their contribution to the satisfaction of the household.The approach essentially modeling and exploratory offers interesting perspectives in the field of urban planning. By using basic and reproducible models, one of the objectives is to build mapping documents describing the potential of satisfaction on a large scale.Laboratoire : ThéMA Equipe : Paysage et cadre de vie Niveau : Recherche Publication de Théma : Oui En ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00903526 Satisfaction rÃĐsidentielle et configurations spatiales en milieu pÃĐriurbain = Residential satisfaction and spatial configurations in a periurban area [thÃĻse] / Samy Youssoufi, Auteur ; Jean-Christophe FoltÊte, Directeur de thÃĻse ; Caruso G., Direction/Jury ; LÃĐna Sanders, Direction/Jury . - ThÃĐMA, 2011 . - 363 p.
Université de Franche-Comté. Thèse de doctorat de géographie
Langues : Français (fre)
Tags : satisfaction rÃĐsidentielle cadre de vie pÃĐriurbain mÃĐtriques spatiales modÃĐlisation amÃĐnitÃĐs paysage accessibilitÃĐ landscape accessibility spatial metrics amenities modelling indicators periurban area residential satisfaction residential environment RÃĐsumÃĐ : Depuis les annÃĐes 1960, les villes françaises sont soumises à un processus d'ÃĐtalement urbain. Cet ÃĐtalement se traduit par l'ÃĐmergence d'une catÃĐgorie d'espace situÃĐe à l'interface entre la ville et la campagne : le pÃĐriurbain. Les caractÃĐristiques sociales, urbanistiques, ou liÃĐes aux pratiques spatiales de ses habitants confÃĻrent au pÃĐriurbain une singularitÃĐ et une spÃĐcificitÃĐ propres. Il s'agit d'un espace de contradiction qui attire à la fois en raison du cadre de vie plutÃīt ÂŦ naturel Âŧ qu'il offre aux mÃĐnages, mais ÃĐgalement en raison de sa proximitÃĐ avec la ville et des potentialitÃĐs liÃĐes à l'accessibilitÃĐ Ã diverses amÃĐnitÃĐs urbaines.Pour comprendre plus finement cet engouement pour le pÃĐriurbain, cette thÃĻse propose d'explorer la relation individu-environnement rÃĐsidentiel sous l'angle de la satisfaction que retirent les individus de leur cadre de vie. Il s'agit de mettre en relation une information de nature cognitive avec une information de nature spatiale. En modÃĐlisant chacune de ces composantes par l'utilisation d'indicateurs spÃĐcifiques, divers modÃĻles statistiques sont mobilisÃĐs pour mettre en lumiÃĻre les attributs spatiaux du cadre de vie susceptibles d'avoir une influence sur la satisfaction des individus.L'approche modÃĐlisatrice est centrale dans la dÃĐmarche suivie. AprÃĻs voir menÃĐ une enquÊte de satisfaction sur plus d'un millier de mÃĐnages vivant dans un secteur pÃĐriurbain de Besançon, la dÃĐmarche s'est attelÃĐe à construire des indicateurs en vue de caractÃĐriser deux types d'amÃĐnitÃĐs de leur environnement rÃĐsidentiel : le paysage et l'accessibilitÃĐ aux commerces et services. Chacune de ces amÃĐnitÃĐs est ensuite intÃĐgrÃĐe dans des modÃĻles statistiques permettant d'ÃĐvaluer leur contribution dans le degrÃĐ de satisfaction du mÃĐnage.La dÃĐmarche, essentiellement modÃĐlisatrice et exploratoire, offre toutefois des perspectives intÃĐressantes dans le domaine de l'amÃĐnagement du territoire et de la planification urbaine. En ayant recours à des modÃĻles simples et reproductibles, il s'agit de d'ÃĐtablir des documents cartographiques dÃĐcrivant le potentiel de satisfaction à grande ÃĐchelle.
Since the 1960s, French cities are concerned with an urban sprawl process. This urban sprawl leads to the emergence of a particular space located at the interface between the city and the countryside: the periurban. The social, morphological or the spatial practices of its inhabitants give the suburban a particular singularity and specificity. It is a space of contradiction that attracts both because of the "natural" living environment that it provides to households, but also because of its proximity to the city and the opportunities related to accessibility to various urban amenities.To understand more precisely this enthusiasm for periurban areas, this thesis proposes to explore the individual-residential environment relationship in terms of the satisfaction. The aim is to link a cognitive information with a spatial information. By modeling each of these components by the use of specific indicators, various statistical models are used to highlight the spatial attributes of the living environment that influence the satisfaction level of individuals.The modeling approach is central in this thesis. After the establishment of a satisfaction survey conducted on more than one thousand households living in a suburban area of ââBesancon, the process is to build indicators to characterize two types of residential amenities: the landscape and the accessibility to shops and services. Each of these amenities is then incorporated into statistical models to assess their contribution to the satisfaction of the household.The approach essentially modeling and exploratory offers interesting perspectives in the field of urban planning. By using basic and reproducible models, one of the objectives is to build mapping documents describing the potential of satisfaction on a large scale.Laboratoire : ThéMA Equipe : Paysage et cadre de vie Niveau : Recherche Publication de Théma : Oui En ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00903526 RÃĐservation
RÃĐserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Section DisponibilitÃĐ 01151001422600 THE.2011.YOU ThÃĻse/MÃĐmoire Centre de Documentation Sorti jusqu'au 18/08/2025
Titre : Structures urbaines, offre de transport et comportements de mobilitÃĐ Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : Jean-Christophe FoltÊte ; Cyrille Genre-Grandpierre ; HÃĐlÃĻne Houot ; Flitti M. AnnÃĐe de publication : 2002 Importance : 199 p. Langues : Français (fre) Tags : Transports MobilitÃĐ Ville Laboratoire : Inconnu Type : Ouvrage Publication de Théma : Non Structures urbaines, offre de transport et comportements de mobilitÃĐ [texte imprimÃĐ] / Jean-Christophe FoltÊte ; Cyrille Genre-Grandpierre ; HÃĐlÃĻne Houot ; Flitti M. . - 2002 . - 199 p.
Langues : Français (fre)
Tags : Transports MobilitÃĐ Ville Laboratoire : Inconnu Type : Ouvrage Publication de Théma : Non RÃĐservation
RÃĐserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Section DisponibilitÃĐ 6109 M.363 Livre Archives Disponible Utilisation conjointe de graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour l'analyse de la connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitants / Paul Savary
Titre : Utilisation conjointe de graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour l'analyse de la connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitants Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : Paul Savary, Auteur ; Jean-Christophe FoltÊte, Directeur de thÃĻse ; StÃĐphane Garnier, Directeur de thÃĻse AnnÃĐe de publication : 2021 Importance : 1 vol.(296 p.) Note gÃĐnÃĐrale : Thèse soutenue le 07-12-2021. Langues : Français (fre) Tags : ÃĐcologie du paysage gÃĐnÃĐtique des populations thÃĐorie des graphes rÃĐseaux connectivitÃĐ des habitats RÃĐsumÃĐ : La connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitats est nÃĐcessaire aux processus ÃĐcologiques assurant le maintien de la biodiversitÃĐ. Des mÃĐthodes ont donc ÃĐtÃĐ dÃĐveloppÃĐes pour la modÃĐliser afin de comprendre prÃĐcisÃĐment son influence et dâorienter les mesures de conservation de la biodiversitÃĐ. Parmi ces mÃĐthodes, les graphes paysagers modÃĐlisent un rÃĐseau dâhabitat sous la forme dâun ensemble de taches dâhabitat (nÅuds) reliÃĐes par des chemins de dispersion potentiels (liens). La validitÃĐ ÃĐcologique de ces outils nÃĐcessitait nÃĐanmoins dâÊtre ÃĐvaluÃĐe à lâaide de donnÃĐes reflÃĐtant les rÃĐponses biologiques des populations à la connectivitÃĐ de leurs habitats. Les donnÃĐes gÃĐnÃĐtiques permettent cette validation car la structure gÃĐnÃĐtique des populations dÃĐpend notamment des flux gÃĐnÃĐtiques entre leurs taches dâhabitat. La structure gÃĐnÃĐtique peut ÃĐgalement Être modÃĐlisÃĐe par un graphe gÃĐnÃĐtique dont les nÅuds correspondent à des populations et dont les liens sont pondÃĐrÃĐs par le degrÃĐ de diffÃĐrenciation gÃĐnÃĐtique entre populations. Lâobjectif de cette thÃĻse ÃĐtait dâutiliser conjointement des graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour (i) ÃĐvaluer la validitÃĐ ÃĐcologique des graphes paysagers et (ii) amÃĐliorer notre comprÃĐhension de la relation entre connectivitÃĐ et structure gÃĐnÃĐtique. AprÃĻs avoir identifiÃĐ les mÃĐthodes de construction et dâanalyse des graphes gÃĐnÃĐtiques les plus adaptÃĐes à chaque contexte et dÃĐveloppÃĐ un outil informatique permettant lâutilisation conjointe des graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers, nous les avons comparÃĐs dans le cadre de deux ÃĐtudes empiriques. Elles ont permis (i) dâÃĐvaluer lâinfluence respective des diffÃĐrentes composantes de la connectivitÃĐ des habitats sur la diversitÃĐ et la diffÃĐrenciation gÃĐnÃĐtiques et (ii) de confirmer la validitÃĐ ÃĐcologique des graphes paysagers. Nous avons ensuite montrÃĐ que lâintÃĐgration de variables associÃĐes à la fois aux nÅuds et aux liens de ces deux types de graphes amÃĐliorait lâestimation de lâinfluence des ÃĐlÃĐments du paysage sur la connectivitÃĐ. Les mÃĐthodes dÃĐveloppÃĐes dans cette thÃĻse pourraient trouver dâautres applications dans ce champ dâÃĐtude comme dans dâautres. Nous espÃĐrons que les rÃĐsultats de cette thÃĻse et lâoutil informatique dÃĐveloppÃĐ y contribueront. Note de contenu : PrÃĐparÃĐe à l'UMR ThÃĐMA et à l'UMR 6282 BiogÃĐosciences (UBFC) - FinancÃĐe par l'entreprise ARP-Astrance. Niveau : Recherche Publication de Théma : Oui Utilisation conjointe de graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour l'analyse de la connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitants [texte imprimÃĐ] / Paul Savary, Auteur ; Jean-Christophe FoltÊte, Directeur de thÃĻse ; StÃĐphane Garnier, Directeur de thÃĻse . - 2021 . - 1 vol.(296 p.).
Thèse soutenue le 07-12-2021.
Langues : Français (fre)
Tags : ÃĐcologie du paysage gÃĐnÃĐtique des populations thÃĐorie des graphes rÃĐseaux connectivitÃĐ des habitats RÃĐsumÃĐ : La connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitats est nÃĐcessaire aux processus ÃĐcologiques assurant le maintien de la biodiversitÃĐ. Des mÃĐthodes ont donc ÃĐtÃĐ dÃĐveloppÃĐes pour la modÃĐliser afin de comprendre prÃĐcisÃĐment son influence et dâorienter les mesures de conservation de la biodiversitÃĐ. Parmi ces mÃĐthodes, les graphes paysagers modÃĐlisent un rÃĐseau dâhabitat sous la forme dâun ensemble de taches dâhabitat (nÅuds) reliÃĐes par des chemins de dispersion potentiels (liens). La validitÃĐ ÃĐcologique de ces outils nÃĐcessitait nÃĐanmoins dâÊtre ÃĐvaluÃĐe à lâaide de donnÃĐes reflÃĐtant les rÃĐponses biologiques des populations à la connectivitÃĐ de leurs habitats. Les donnÃĐes gÃĐnÃĐtiques permettent cette validation car la structure gÃĐnÃĐtique des populations dÃĐpend notamment des flux gÃĐnÃĐtiques entre leurs taches dâhabitat. La structure gÃĐnÃĐtique peut ÃĐgalement Être modÃĐlisÃĐe par un graphe gÃĐnÃĐtique dont les nÅuds correspondent à des populations et dont les liens sont pondÃĐrÃĐs par le degrÃĐ de diffÃĐrenciation gÃĐnÃĐtique entre populations. Lâobjectif de cette thÃĻse ÃĐtait dâutiliser conjointement des graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour (i) ÃĐvaluer la validitÃĐ ÃĐcologique des graphes paysagers et (ii) amÃĐliorer notre comprÃĐhension de la relation entre connectivitÃĐ et structure gÃĐnÃĐtique. AprÃĻs avoir identifiÃĐ les mÃĐthodes de construction et dâanalyse des graphes gÃĐnÃĐtiques les plus adaptÃĐes à chaque contexte et dÃĐveloppÃĐ un outil informatique permettant lâutilisation conjointe des graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers, nous les avons comparÃĐs dans le cadre de deux ÃĐtudes empiriques. Elles ont permis (i) dâÃĐvaluer lâinfluence respective des diffÃĐrentes composantes de la connectivitÃĐ des habitats sur la diversitÃĐ et la diffÃĐrenciation gÃĐnÃĐtiques et (ii) de confirmer la validitÃĐ ÃĐcologique des graphes paysagers. Nous avons ensuite montrÃĐ que lâintÃĐgration de variables associÃĐes à la fois aux nÅuds et aux liens de ces deux types de graphes amÃĐliorait lâestimation de lâinfluence des ÃĐlÃĐments du paysage sur la connectivitÃĐ. Les mÃĐthodes dÃĐveloppÃĐes dans cette thÃĻse pourraient trouver dâautres applications dans ce champ dâÃĐtude comme dans dâautres. Nous espÃĐrons que les rÃĐsultats de cette thÃĻse et lâoutil informatique dÃĐveloppÃĐ y contribueront. Note de contenu : PrÃĐparÃĐe à l'UMR ThÃĐMA et à l'UMR 6282 BiogÃĐosciences (UBFC) - FinancÃĐe par l'entreprise ARP-Astrance. Niveau : Recherche Publication de Théma : Oui RÃĐservation
RÃĐserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Section DisponibilitÃĐ 01151001949657 THE.2021.SAV Livre Centre de Documentation Disponible Utilisation conjointe de graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour l'analyse de la connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitants / Paul Savary
Titre : Utilisation conjointe de graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour l'analyse de la connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitants : Annexes A - articles scientifiques Type de document : texte imprimÃĐ Auteurs : Paul Savary, Auteur ; Jean-Christophe FoltÊte, Directeur de thÃĻse ; StÃĐphane Garnier, Directeur de thÃĻse AnnÃĐe de publication : 2021 Importance : 1 vol.(205 p.) Note gÃĐnÃĐrale : Thèse soutenue le 07-12-2021. Langues : Français (fre) Tags : ÃĐcologie du paysage gÃĐnÃĐtique des populations thÃĐorie des graphes rÃĐseaux connectivitÃĐ des habitats RÃĐsumÃĐ : La connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitats est nÃĐcessaire aux processus ÃĐcologiques assurant le maintien de la biodiversitÃĐ. Des mÃĐthodes ont donc ÃĐtÃĐ dÃĐveloppÃĐes pour la modÃĐliser afin de comprendre prÃĐcisÃĐment son influence et dâorienter les mesures de conservation de la biodiversitÃĐ. Parmi ces mÃĐthodes, les graphes paysagers modÃĐlisent un rÃĐseau dâhabitat sous la forme dâun ensemble de taches dâhabitat (nÅuds) reliÃĐes par des chemins de dispersion potentiels (liens). La validitÃĐ ÃĐcologique de ces outils nÃĐcessitait nÃĐanmoins dâÊtre ÃĐvaluÃĐe à lâaide de donnÃĐes reflÃĐtant les rÃĐponses biologiques des populations à la connectivitÃĐ de leurs habitats. Les donnÃĐes gÃĐnÃĐtiques permettent cette validation car la structure gÃĐnÃĐtique des populations dÃĐpend notamment des flux gÃĐnÃĐtiques entre leurs taches dâhabitat. La structure gÃĐnÃĐtique peut ÃĐgalement Être modÃĐlisÃĐe par un graphe gÃĐnÃĐtique dont les nÅuds correspondent à des populations et dont les liens sont pondÃĐrÃĐs par le degrÃĐ de diffÃĐrenciation gÃĐnÃĐtique entre populations. Lâobjectif de cette thÃĻse ÃĐtait dâutiliser conjointement des graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour (i) ÃĐvaluer la validitÃĐ ÃĐcologique des graphes paysagers et (ii) amÃĐliorer notre comprÃĐhension de la relation entre connectivitÃĐ et structure gÃĐnÃĐtique. AprÃĻs avoir identifiÃĐ les mÃĐthodes de construction et dâanalyse des graphes gÃĐnÃĐtiques les plus adaptÃĐes à chaque contexte et dÃĐveloppÃĐ un outil informatique permettant lâutilisation conjointe des graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers, nous les avons comparÃĐs dans le cadre de deux ÃĐtudes empiriques. Elles ont permis (i) dâÃĐvaluer lâinfluence respective des diffÃĐrentes composantes de la connectivitÃĐ des habitats sur la diversitÃĐ et la diffÃĐrenciation gÃĐnÃĐtiques et (ii) de confirmer la validitÃĐ ÃĐcologique des graphes paysagers. Nous avons ensuite montrÃĐ que lâintÃĐgration de variables associÃĐes à la fois aux nÅuds et aux liens de ces deux types de graphes amÃĐliorait lâestimation de lâinfluence des ÃĐlÃĐments du paysage sur la connectivitÃĐ. Les mÃĐthodes dÃĐveloppÃĐes dans cette thÃĻse pourraient trouver dâautres applications dans ce champ dâÃĐtude comme dans dâautres. Nous espÃĐrons que les rÃĐsultats de cette thÃĻse et lâoutil informatique dÃĐveloppÃĐ y contribueront. Note de contenu : PrÃĐparÃĐe à l'UMR ThÃĐMA et à l'UMR 6282 BiogÃĐosciences (UBFC) - FinancÃĐe par l'entreprise ARP-Astrance. Niveau : Recherche Publication de Théma : Oui Utilisation conjointe de graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour l'analyse de la connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitants : Annexes A - articles scientifiques [texte imprimÃĐ] / Paul Savary, Auteur ; Jean-Christophe FoltÊte, Directeur de thÃĻse ; StÃĐphane Garnier, Directeur de thÃĻse . - 2021 . - 1 vol.(205 p.).
Thèse soutenue le 07-12-2021.
Langues : Français (fre)
Tags : ÃĐcologie du paysage gÃĐnÃĐtique des populations thÃĐorie des graphes rÃĐseaux connectivitÃĐ des habitats RÃĐsumÃĐ : La connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitats est nÃĐcessaire aux processus ÃĐcologiques assurant le maintien de la biodiversitÃĐ. Des mÃĐthodes ont donc ÃĐtÃĐ dÃĐveloppÃĐes pour la modÃĐliser afin de comprendre prÃĐcisÃĐment son influence et dâorienter les mesures de conservation de la biodiversitÃĐ. Parmi ces mÃĐthodes, les graphes paysagers modÃĐlisent un rÃĐseau dâhabitat sous la forme dâun ensemble de taches dâhabitat (nÅuds) reliÃĐes par des chemins de dispersion potentiels (liens). La validitÃĐ ÃĐcologique de ces outils nÃĐcessitait nÃĐanmoins dâÊtre ÃĐvaluÃĐe à lâaide de donnÃĐes reflÃĐtant les rÃĐponses biologiques des populations à la connectivitÃĐ de leurs habitats. Les donnÃĐes gÃĐnÃĐtiques permettent cette validation car la structure gÃĐnÃĐtique des populations dÃĐpend notamment des flux gÃĐnÃĐtiques entre leurs taches dâhabitat. La structure gÃĐnÃĐtique peut ÃĐgalement Être modÃĐlisÃĐe par un graphe gÃĐnÃĐtique dont les nÅuds correspondent à des populations et dont les liens sont pondÃĐrÃĐs par le degrÃĐ de diffÃĐrenciation gÃĐnÃĐtique entre populations. Lâobjectif de cette thÃĻse ÃĐtait dâutiliser conjointement des graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour (i) ÃĐvaluer la validitÃĐ ÃĐcologique des graphes paysagers et (ii) amÃĐliorer notre comprÃĐhension de la relation entre connectivitÃĐ et structure gÃĐnÃĐtique. AprÃĻs avoir identifiÃĐ les mÃĐthodes de construction et dâanalyse des graphes gÃĐnÃĐtiques les plus adaptÃĐes à chaque contexte et dÃĐveloppÃĐ un outil informatique permettant lâutilisation conjointe des graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers, nous les avons comparÃĐs dans le cadre de deux ÃĐtudes empiriques. Elles ont permis (i) dâÃĐvaluer lâinfluence respective des diffÃĐrentes composantes de la connectivitÃĐ des habitats sur la diversitÃĐ et la diffÃĐrenciation gÃĐnÃĐtiques et (ii) de confirmer la validitÃĐ ÃĐcologique des graphes paysagers. Nous avons ensuite montrÃĐ que lâintÃĐgration de variables associÃĐes à la fois aux nÅuds et aux liens de ces deux types de graphes amÃĐliorait lâestimation de lâinfluence des ÃĐlÃĐments du paysage sur la connectivitÃĐ. Les mÃĐthodes dÃĐveloppÃĐes dans cette thÃĻse pourraient trouver dâautres applications dans ce champ dâÃĐtude comme dans dâautres. Nous espÃĐrons que les rÃĐsultats de cette thÃĻse et lâoutil informatique dÃĐveloppÃĐ y contribueront. Note de contenu : PrÃĐparÃĐe à l'UMR ThÃĐMA et à l'UMR 6282 BiogÃĐosciences (UBFC) - FinancÃĐe par l'entreprise ARP-Astrance. Niveau : Recherche Publication de Théma : Oui RÃĐservation
RÃĐserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Section DisponibilitÃĐ 01151003090159 THE.2021.SAV.2 Livre Centre de Documentation Disponible Utilisation conjointe de graphes gÃĐnÃĐtiques et paysagers pour l'analyse de la connectivitÃĐ ÃĐcologique des habitants / Paul Savary
PermalinkPermalink